Jean-Luc Englebert, de la BD à l’illustration jeunesse
Avec une trentaine d’albums à son actif, J.-L. Englebert jongle habilement avec les techniques d’illustration. Voyage dans son univers suite à la carte blanche qui lui a été donnée au centre de littérature de jeunesse de Bruxelles le 23 octobre 2018.
Avec une trentaine d’albums à son actif, J.-L. Englebert jongle habilement avec les techniques d’illustration. Voyage dans son univers suite à la carte blanche qui lui a été donnée au centre de littérature de jeunesse de Bruxelles le 23 octobre 2018.
Cet article a initialement été publié dans la revue belge Lectures.Cultures (n°12, mars-avril 2019). Nous reproduisons ici le texte de l'article avec l'aimable autorisation de son auteure, Isabelle Decuyper, et de Lectures.Cultures. Les images proviennent des différents éditeurs et de Jean-Luc Englebert.

Isabelle Decuyper: Qui êtes-vous?
Jean-Luc Englebert: Je suis né à Herve d’une mère institutrice et d’un père boucher-charcutier. Dans ma famille, il y avait très peu d’images. Mon père m’offrait des BD, des Gaston Lagaffe et des Tintin. Je suis donc entré dans le dessin par la BD. J’avais 9 ans quand j’ai su que je voulais être dessinateur. Ce qui me plaisait, c’était raconter une histoire. Sans qu’on ait besoin de lire les textes, Hergé arrivait à faire comprendre son histoire par son découpage, comme dans Les Bijoux de la Castafiore.
J’ai appris à dessiner en recopiant les dessins. Plus tard, vers 12 ans, j’ai rencontré Walthéry, qui m’a montré les techniques pour réaliser une BD, notamment la respiration d’une case ou comment ne pas coller la bulle au personnage. Lors de mes 5e et 6e secondaires à l’école Saint-Luc à Liège, j’ai été confronté au dessin d’après nature, au modèle vivant. J’ai appris qu’il existait d’autres formes de dessins. À partir de là, ce fut pour moi… l’arrêt de la BD. Mon travail de fin d’année, Le cimetière des éléphants, s’est trouvé dans un magasin de Verviers. J’ai découvert Mattotti, dessinateur en couleurs directes[1], et j’ai appris comment faire une BD avec des formes géométriques abstraites.
En 1986, je décide de monter à Saint-Luc Bruxelles, la seule école proposant une section BD. Il n’y avait que des garçons. Pendant trois ans, j’ai donc réappris à faire de la BD. Nous avions un cours en commun avec la section «illustration», où il n’y avait que des filles, et une fille dont je suis tombé amoureux m’a fait découvrir les livres pour enfants[2]. Durant mes études de BD, j’ai beaucoup travaillé le découpage et le scénario. Le découpage dessiné doit tenir avec ou sans texte. C’est une technique que je garde encore dans les livres pour enfants.
En 1988, lors d’une conférence à Saint-Luc, Christiane Germain a présenté la nouvelle maison d’édition Pastel sur Bruxelles. J’ai découvert l’importance de L’école des loisirs. C. Germain a trouvé que j’avais un dessin trop typé BD. Durant deux ans, j’ai réappris à dessiner en empruntant dans les bibliothèques[3], relâchant mon dessin en le réalisant au crayon le plus librement possible et le montrant régulièrement à Christiane, qui a adoré le dessin de Ourson a disparu[4], créé en 1993. Ce fut un cheminement de deux ans de réapprentissage du dessin.
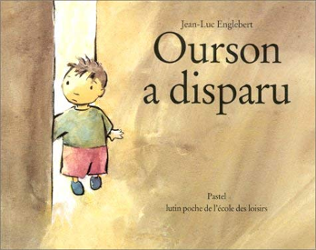
Ce qui m’intéresse le plus chez les dessinateurs comme Q. Blake, Sempé ou A. Lobel, c’est la sensation qu’on retient en voyant l’image. Aller à l’essentiel, ne pas en rajouter. J’ai fait partie du collectif Moka qui est devenu Frémok. On a fait un seul numéro BD prise de tête. Mais je voulais avant tout raconter des histoires, retourner vers l’univers de l’enfant. Les magazines étaient de vrais tremplins pour commencer une carrière en BD. Fin des années 1980, début 1990, ce fut la première crise de la BD. On évoquait déjà la surproduction. On s’est donc retrouvé avec le seul Spirou magazine. Ce qui était chouette, c’était le cours d’histoire de l’art, qui manque vraiment dans les écoles «classiques». Cours de BD, de photo, peintres chinois et japonais, qui m’ont influencé…, en Europe, Edward Hopper. Ces deux années ont été un accélérateur. Apprendre à dessiner des humains d’après des poses est déterminant pour comprendre comment bougent les personnages.
Deux nouveautés: L’anorak rouge et L’été de l’indien et… improvisation!
J’avais inventé un gamin et une petite fille dans les années 1970. Ceux-ci font l’objet de deux albums qui viennent de paraître[5].

Quand je dessine, j’improvise vraiment. Je ne sais pas où je vais. J’invente déjà un peu le texte, mais toujours avec le support dessin d’abord. C’est avec ce découpage en chemin de fer que je vais expliquer le projet chez Pastel, puis j’écris l’histoire dessus. J’ai une image en tête, et à partir de celle-ci se greffe ou non une histoire. Comme cette histoire de crêpes en dernière image dans l’album L’été de l’indien[6], prévu en juin 2019, qui est un hommage à Petzi qui vivait ses aventures seul sans ses parents.

Comment apprendre à dessiner sans savoir dessiner?
Cela fait presque 30 ans que je fais des livres à l’aquarelle, et je découvre encore cette technique. J’utilise divers types de pinceaux pour gratter dans l’aquarelle et rendre l’herbe à ma façon. Je fais beaucoup de recherches avant d’arriver à dessiner un album. La tache est un exercice que je fais toujours avec un bâton d’encre de Chine diluée. À partir de taches, je fais des dessins[7]. Dessiner uniquement au pinceau m’a permis de libérer mon dessin. J’ai initié une série de dessins à l’encre de Chine, qui sont des exercices pour dessiner différemment, comme un entraînement sportif que je m’impose pour passer de la BD au livre pour enfant, et vice versa.
Après Ourson a disparu, j’ai fait un deuxième livre: Je suis le roi. C. Germain m’a fait rencontrer Mario Ramos et Andréa Nève, avec laquelle j’ai fait trois livres. Les côtoyer fut un autre déclencheur. Les discussions avec Mario, qui m’a fait découvrir beaucoup de choses, sa passion pour Tomi Ungerer, ce qu’il faisait quand il ne créait pas de livres pour enfants. Je me souviens que nous parlions de voir comment aller à l’essentiel sans se tromper. Maintenant, quand je raconte une histoire, je fais d’abord le dessin, qui doit venir seul, le texte étant presque de la décoration. Illustrer l’univers de quelqu’un d’autre, dans lequel je dois entrer, représente une autre difficulté. Il m’est difficile de travailler avec un auteur, car je dois faire mien son texte; ce qui demande plus de recherches dans mes carnets.
Dans l’autre sens, l’histoire de l’album Hortensia a été inventée par la romancière Marie Chartres, voyant le dessin d’un chien. Le texte est très séquencé. Je devais donc trouver le rythme du dessin: une double page puis un dessin en page de gauche et deux dessins à droite. Quand le chien rencontre l’âne, le découpage change. Je découpe le texte de l’auteur et je le place dans le dessin. J’ai aussi illustré le dernier roman de M. Chartres: Un caillou dans la poche. J’ai choisi le lettrage.

Depuis 2008 trotte dans ma tête un personnage de petite fille sorcière, qui a fait l’objet d’une affiche de L’école des loisirs. La princesse Raiponce à la chevelure noire sort de sa tour vers la boulangerie; elle se fait couper les cheveux et devient une sorcière. Dans mes carnets, j’ai des amorces d’histoires, de dessins. L’histoire se fera ou… pas. Je montre toujours mes recherches chez Pastel, où on a une totale liberté. Quand je travaille avec un auteur, je ne peux pas improviser. Alors, je fais autre chose que ce que je crée habituellement: des couteaux, des dragons quand j’ai travaillé avec Andréa Nève. Je sors de ma zone de confort. Même chose avec Ludovic Flamant pour Les poupées c’est pour les filles. J’aime bien dessiner des personnages. Or, dans ce cas-ci, ce sont des personnages qui se parlent. J’ai donc essayé de me rapprocher de dessinateurs comme Q. Blake. La chasse au Dragon, avec A. Nève, fut un jeu de ping-pong jusqu’à la fin.
J’utilise une table lumineuse pour recopier. Comme la même maison que je décalquais et dont je changeais des éléments. J’avais déjà initié cela dans Le château du petit prince. Je n’utilise pas d’ordinateur. Je scanne mes dessins pour avoir des traces.
Contexte de la création?
Je travaille tout le temps en musique. Lors des phases de recherche d’écriture, c’est un trio de piano calme. Si je dessine, c’est une chanteuse de jazz. J’ai besoin d’un fond musical en permanence. Dans un atelier collectif, je trouve une discipline, une espèce de concentration, mais je garde un casque.
Des influences?
Léon Spilliaert, un peintre très illustratif que j’aime beaucoup; Carl Larsson, aquarelliste; Chu Ta, peintre chinois qui fait des fleurs avec des taches, ou comment arriver avec un seul trait à faire un personnage. C’est la somme de tous les traits dessinés précédemment.
[1] En utilisant des crayons de couleur, des pastels gras.
[2] Notamment Solotareff.
[3] Solotareff, Elzbieta, William Steig, Quentin Blake…
[4] Paru chez Pastel en 1994.
[5] Chez Gallimard Jeunesse dans la collection «Giboulées».
[6] Qui raconte l’histoire d’un moment de vacances sur l’île de Sein en Bretagne que Jean-Luc Englebert affectionne particulièrement.
[7] Voir la page Facebook de J.-L. Englebert: les «cafés du matin».

