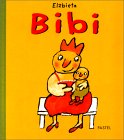Des enfants à croquer

Monstres des placards, forêts remplies de loups, sorcières rusées ou croque-mitaines (terribles associés de l’autorité parentale), les mangeurs d’enfants peuplent histoires et contes. Pour faire peur ou se faire peur, rien ne vaut cette terrifiante menace, celle de la plus totale des disparitions : finir digéré !
Dans le panthéon des croqueurs de marmots, les ogres occupent une place de choix. Géants sanguinaires aveuglés par la faim, bêtes et méchants, ils tiennent un couteau à la main, portent une longue barbe et sont sans pitié. C’est du moins l’archétype de l’ogre traditionnel qui, tout en ressemblant fort à un humain, ne doit pas en être un. L’ogre généralement ne porte pas de nom, car le nom humanise. Quant au mot OGRE lui-même, avec ce O initial comme une bouche grande ouverte, puis un GRRR entre rugissement et grognement, il nous fait froid dans le dos. Sauve qui peut, cachons nos enfants !
Mais si l’ogre du Petit Poucet se reconnaîtra dans ce portrait, il en va différemment de certains ogres contemporains, qui ne sont souvent plus si méchants que ça. Les amis de Shrek ne diraient pas le contraire. Avant d’aller jeter un œil dans quelques albums d’aujourd’hui, réfléchissons ensemble à cet inquiétant personnage.
Jouer sur les mots
Si l’ogre inquiète, c’est que sa nature est souvent incertaine. Quantité d’histoires tournent autour du soupçon : cet homme est-il un ogre ou porte-t-il simplement une grosse barbe, cette femme aux si longues dents est-elle bien innocente ? Après tout, du point de vue d’un petit enfant, chaque adulte est immense, c’est une question de proportions, et les ogres sont des géants. Avec son petit livre L’Ogre (Rouergue, 2001), Olivier Douzou illustre cette question du point de vue en racontant comment une fourmi se fait avaler par un petit garçon qui dort la bouche ouverte.
Tout de même, soyons honnêtes, les enfants n’ont pas tout tort de se méfier. Rares sont ceux qui n’ont pas entendu au creux de leur oreille : «Tu es si mignon que je voudrais te manger, tu es à croquer !» Et quand vient l’heure de se mettre à table, après avoir mordillé les pieds et les mains des bébés alentour, les adultes carnivores aiment à déguster tendrons de veau et côtes d’agneau. Oui, il y a de quoi se méfier…
Le livre de Sophie Chérer, L’Ogre maigre et l’enfant fou (L’Ecole des loisirs, 2002), fait ce rapprochement : dans le monde des ogres, on décide d’élever les enfants en batterie, histoire d’en avoir plus, tout le temps et sans effort. Malheureusement, les enfants se mettent à trembler, à baver et à mourir de la maladie de l’enfant fou. Une critique vive et intelligente de notre société de surconsommation.
Les parents ogres ou la peur au ventre
Parmi les ogres, les plus terribles sont les parents qui ne peuvent s’empêcher de manger leurs enfants. Que l’acte soit métaphorique – amour ou colère prennent l’apparence d’une dévoration – ou que le monstrueux personnage annihile littéralement sa propre descendance, difficile de faire pire ; rien n’est plus effrayant qu’un ennemi dans sa propre maison.
L’histoire ne date pas d’hier. Dans la mythologie grecque, le Titan Cronos dévore ses enfants dès que son épouse Rhéa les met au monde, ne laissant à ces derniers que le temps de passer d’un ventre à l’autre. Figure d’un père tout-puissant, aveuglé par la peur de perdre ce pouvoir total, il ne voit dans sa descendance que le signe tangible de sa mort inéluctable. (A propos du père dévorant et de la pédophobie à travers les âges, je renvoie au livre magnifique de Pierre Péju L’Enfance obscure (Gallimard, 2011), et aux pages 234-237 notamment. C’est Péju qui m’a rappelé aussi cette phrase de Hegel : « Les enfants sont la mort des parents ».)
Mais on ne peut lutter contre le temps qui fait son œuvre, et contre la filiation. C’est bien son fils Zeus, sauvé par Rhéa, qui renversera le tyran et le précipitera dans le Tartare.
Les ogres sont aveuglés par leurs désirs ; désir de régner à jamais ou désir de satisfaire sa propre faim (l’ogre du Petit Poucet égorge ses filles par erreur…), il s’agit, d’une manière ou d’une autre, d’être le plus puissant. On comprend bien pourquoi certains dictateurs furent représentés sous la forme d’ogres dévorant le peuple. Cette exigence de tout maîtriser trahit un refus de laisser aux enfants la place qui leur est due. Pourtant, pour que les enfants puissent grandir et endosser leur rôle de succession, il faut faire de la place, beaucoup de place !
Les figures d’ogresses sont plus rares et leur attitude est plus ambiguë encore. Elles sont souvent les alliées des enfants menacés (là aussi on pense au Petit Poucet). Ou alors, si ces mères-là dévorent, c’est d’amour : elles semblent dire à leur enfant : « Retourne donc dans mon ventre que tu n’aurais pas dû quitter… » La figure symbolique d’une mère trop possessive, dépeinte sous les traits d’une ogresse, trouve çà et là une place dans la littérature pour adultes, mais il est difficile d’en trouver dans la littérature jeunesse contemporaine. La maman étouffante du petit Bibi, dans le livre éponyme d’Elzbieta (Bibi, L’Ecole des loisirs, 1998) évoque plutôt la poule. Quant à L’Ogresse en pleurs (Milan Jeunesse, 1996), il est grand temps d’en parler.
La pire des vilenies
L’archétype de l’ogre masculin mangeant sans discernement sa propre descendance rend d’autant plus troublante la lecture du récit de Valérie Dayre illustré par Wolf Erlbruch : L’Ogresse en pleurs.
Une méchante femme a faim et cherche un enfant à manger. Quand enfin elle en trouve un à son goût, elle n’en fait qu’une bouchée. Malheureusement, cet enfant était le sien. Désormais c’est un enfant à aimer qu’elle cherche avec désespoir. Clairement situé dans l’univers du conte, où temps et lieu ne sont pas définis, le texte poétique de Valérie Dayre joue avec les mots et résiste à l’interprétation unique. La conclusion le dit : «les mots sont confondants».
Est-ce l’histoire d’un amour sans limites qui pousse la méchante femme à croquer son propre enfant ? Son déni, sa mauvaise foi («on m’a pris le mien. On me l’a mangé.») semblent vouloir dire qu’elle n’a pas compris son propre geste. Et sa recherche éperdue d’un enfant à aimer rend l’histoire d’autant plus triste. Sans doute est-ce rassurant de ne voir ici qu’un terrible malentendu. Ouf, la sacro-sainte figure maternelle ne sera pas écorchée ! Car il en faut du courage aujourd’hui pour dépeindre dans un album une méchante maman.
Mais le texte dit aussi que cette femme affreuse « avait commis bien des vilenies dans sa vie ». Et qui donc est cette mère qui ne se souvient même plus avoir un petit jusqu’au moment où elle le trouve à croquer ? Quelle est cette mère aveuglée par sa propre faim qui, dans sa terrifiante quête, est prête à dévorer « mille et un » marmots ? Ne serait-il pas question ici de maltraitance maternelle tout simplement, quelles qu’en soient les manifestations (de la négligence à la violence physique) et les origines ? Le portrait hideux qu’Erlbruch fait de l’ogresse aux mains tordues et au sourire inversé, fortement contrasté par les visages apaisés des lunes et de certains enfants, contribue à plonger les lecteurs dans la peur.
L’acte sanguinaire lui-même n’est pas montré et le mot ogresse n’est jamais prononcé (excepté dans le titre). Quant aux rimes, elles tempèrent la rudesse du propos. Ces choix subtils renforcent le récit qui endosse ici un rôle fondamental : celui de mettre des mots et des images sur l’impensable, sur l’indicible, afin de raconter ce que l’on redoute, ce que l’on inflige, ce que l’on peut vivre ou voir, et que l’on souhaiterait ne jamais exister.

Les ogres ne sont plus ce qu’ils étaient
L’Ogresse en pleurs reste un cas à part dans la production contemporaine où les ogres ont plutôt tendance à s’adoucir. Ce n’est peut-être pas si étonnant. Avant la contraception et les progrès de la médecine, les enfants pouvaient tout autant représenter trop de bouches à nourrir (Le Petit Poucet ne raconte pas autre chose) que des êtres fragiles qui mouraient en masse, comme mouraient en couches les mères. L’enfant, c’était à la fois la promesse d’une nouvelle vie et l’annonce d’un danger de mort, de là sans doute viennent les innombrables contes d’enfants ingurgités.
A l’heure des enfants choisis, voire uniques, on n’évoque plus sans larmes leur possible mort. Alors les parents sanguinaires qui se jettent sur leurs petits, non merci !
Figure par excellence de l’ogre moderne, le célèbre Shrek, héros du film qui porte son nom (2001 pour le premier épisode), est plus malin que les bêtes qui l’entourent et surtout, ne mange pas d’enfants. Il vaut la peine de revenir au livre Shrek, signé William Steig, qui inspira les films (édition originale Strauss & Giroud, 1990, chez Albin Michel Jeunesse, 2007). On y retrouve un personnage particulièrement repoussant, plus laid que son père et sa mère réunis, et qui se marie avec une répugnante princesse : « Et ils vécurent horribles à jamais, terrorisant tous ceux qui leur cherchaient des crosses. » Mais d’enfants dégustés, il n’est pas question. En effet, le texte ne dit jamais de son héros qu’il est un ogre. Shrek étant d’ailleurs le seul personnage qui porte un nom, entouré d’une sorcière, d’un dragon, d’un paysan, d’un chevalier qui eux sont réduits à leur fonction.
En reprenant cette monstruosité physique tout en y ajoutant la terrible réputation attachée au personnage traditionnel de l’ogre, les créateurs du Shrek sur grand écran amplifient encore son capital de sympathie. Au fond, le bonhomme vert est un romantique incompris, victime de son apparence.
On retrouve plusieurs exemples de ces ogres injustement discriminés dans les albums contemporains.
Avec Mon ogre est un papa (L’Ecole des loisirs, 2008), Charles Castella propose aux jeunes lecteurs une histoire tendre (comme une viande ?...) où un bébé abandonné est recueilli par un ogre. Sur l’air de « je le mangerai plus tard » se joue la partition de l’attachement et, peu à peu, le petit Gringalet aime ce drôle de papa qui ne le trouve jamais assez gros. Dans toute la seconde partie du récit, s’opère la métamorphose du personnage. L’ogre libère le village des pillards et on l’acclame comme un héros, puis – le comble pour un ogre – il devient allergique à la viande d’hommes. Le méchant a complètement disparu, au fond il n’était pas si mauvais. Il est devenu un papa, pour le plus grand bonheur de Gringalet.
Dans la sympathique série Le Roi des ogres, de Didier Lévy (Nathan, 2002), on s’éloigne encore de l’archétype du grand méchant. Il ne reste des attributs de l’ogre qu’un fond de bêtise pataude et l’on serait plutôt du côté du bon roi Dagobert. Dans Le Roi des ogres au bal des ogresses, notre héros refuse de sortir de son lit : intimidé par les filles, il a peur d’aller au bal. Heureusement que son cuisinier Waldemar, caché dans sa poche, est là pour l’aider. D’ailleurs ce roi-là s’appelle Bouba, cela ne vous rappelle pas un petit ourson innocent ? Les joyeux dessins d’Anne Wilsdorf font de ce personnage un vrai gentil.
Citons enfin la belle histoire du fils de l’ogre Morillon, contée en vers par Rascal, où le garçon qui n’a rien hérité de son père mange « la bonne soupe de […] maman ». Injustement enlevé par les soldats, il s’échappe de sa cage et libère à son tour une fille de sorcière. De leur union naîtront « trois petits Morillon ». « Seront-ils ogres ou sorcières ? Paraît que c’est pas héréditaire. » (La Nuit des Cages, illustré par Simon Hureau, Didier Jeunesse, 2007).
Enfin, pour écarter toute idée de parent indélicat, rien ne vaut un personnage d’enfant ogre qui mange ses pairs. Dans Paul chasseur d’ogre (David Wautier, Alice Jeunesse, 2003), c’est bien le fils de l’ogre qui se régale de ses amis, tandis que le papa prend un rôle secondaire. La chute du livre se veut apaisante : le petit Paul a seulement fait un cauchemar. Pour se rassurer, bien au chaud entre les bras de sa maman, il lit une histoire d’ogres. Tout le monde est content : les ogres appartiennent au monde des rêves et des livres.

Une part de sauvagerie
On ne saurait parler d’enfants ogres sans commenter les dernières pages de deux livres essentiels : Le Géant de Zeralda (Tomi Ungerer, L’Ecole des loisirs, 1971 pour la première édition française) et Le Déjeuner de la petite ogresse (Anaïs Vaugelade, L’Ecole des loisirs, 2002).
Rappelons que l’ogre d’Ungerer se révèle un fin gourmet qui préfère déguster les petits plats de Zeralda que Zeralda elle-même, du moins au sens propre. Il renonce d’ailleurs totalement à se nourrir d’enfants.
Le dernier dessin d’Ungerer nous offre, non sans humour, l’image d’un ogre apprivoisé. Aux côtés de Zeralda devenue son épouse, le géant présente un sourire gêné presque sans dents, il a troqué son débardeur contre un habit bouffant et rasé sa longue «barbe piquante» : l’homme sauvage et poilu, souvent présent dans les récits du folklore européen, est sorti de la forêt pour rejoindre, le menton glabre, le monde des humains. Le bois de la rencontre entre la petite et le géant a cédé la place à un jardin aux rosiers agencés et les personnages sont représentés dans un cadre. Serait-ce le tableau d’une famille idéale ? Pas tout à fait : au premier plan, l’un des fils de l’ogre cache derrière son dos fourchette et couteau. On ne voit pas le visage de l’enfant, mais il y a fort à parier qu’il salive déjà en observant le nouveau-né bien rose dans les bras de sa maman. Les chats ne font pas des chiens…
Dans la veine des mariages mixtes, Le Déjeuner de la petite ogresse met en scène la rencontre d’une ogresse orpheline et d’un petit garçon que cette dernière a capturé. Avec la finesse et le talent qui la caractérisent, Anaïs Vaugelade raconte le dilemme de la petite qui cherche à résister à sa nature en cessant de s’alimenter, mais ne peut s’empêcher de mordre la main de son prisonnier. Les années passent et les deux amis finissent par se marier et par avoir plein d’enfants aux dents pointues. Si l’ogresse promet de ne plus manger personne, ce n’est peut-être pas le choix de tout le monde. La dernière image nous montre une toute petite fille blonde qui, comme le faisait sa maman, construit un piège pour enfants.
Goûtons à notre tour ces fins malicieuses. Elles sont là pour nous rappeler qu’on ne peut pas tout apprivoiser. Il est bon qu’il demeure une part de sauvagerie. A nous d’en faire le symbole d’une liberté sur laquelle il faut veiller.
Cet article a paru dans le numéro 1.13 de la revue Parole de l'Institut suisse Jeunesse et Médias
13.06.2013